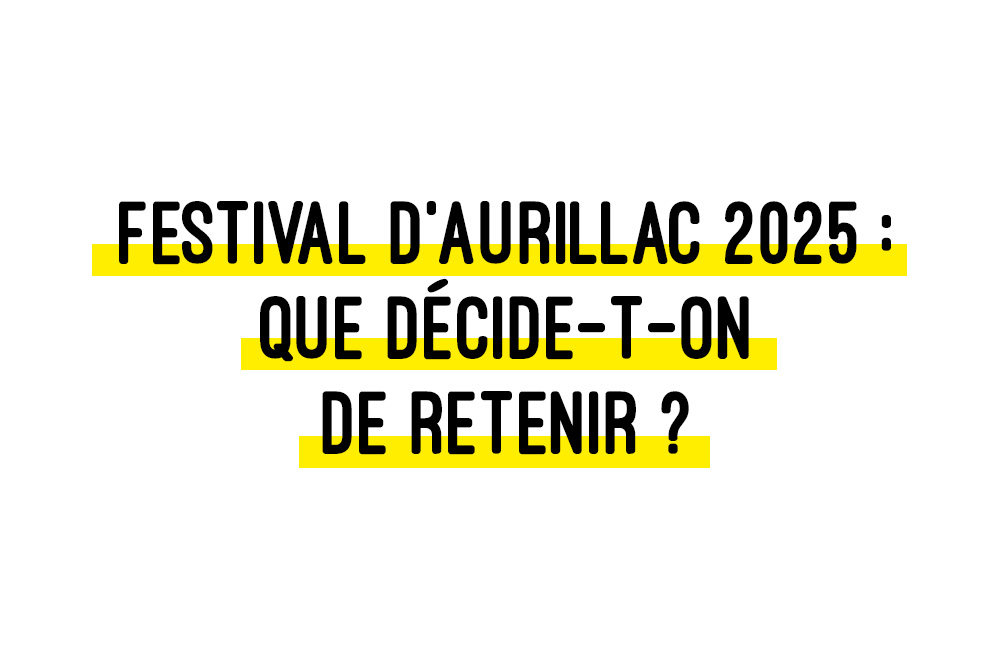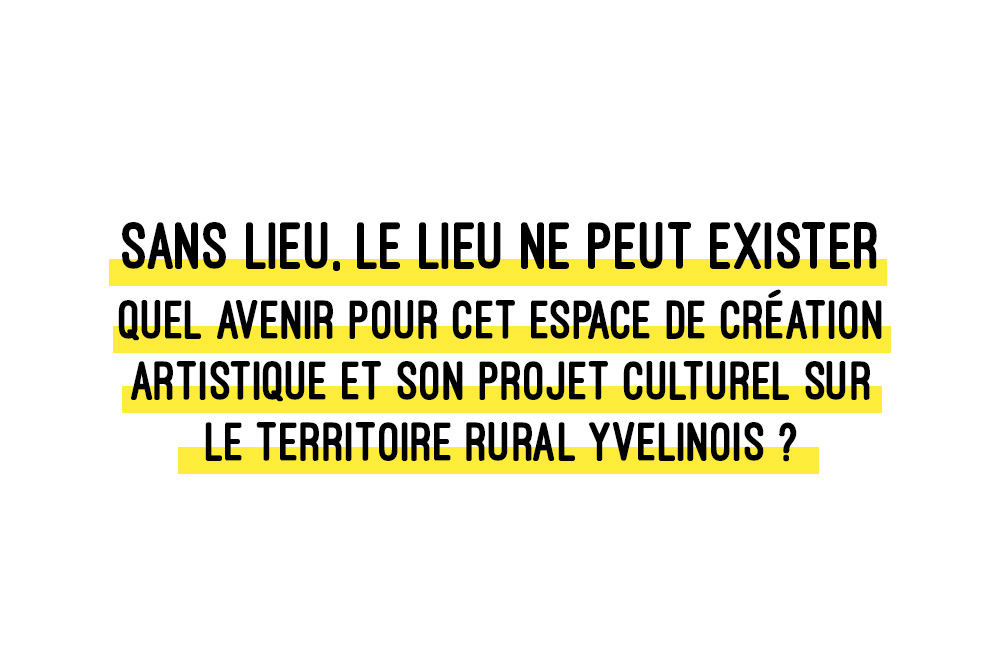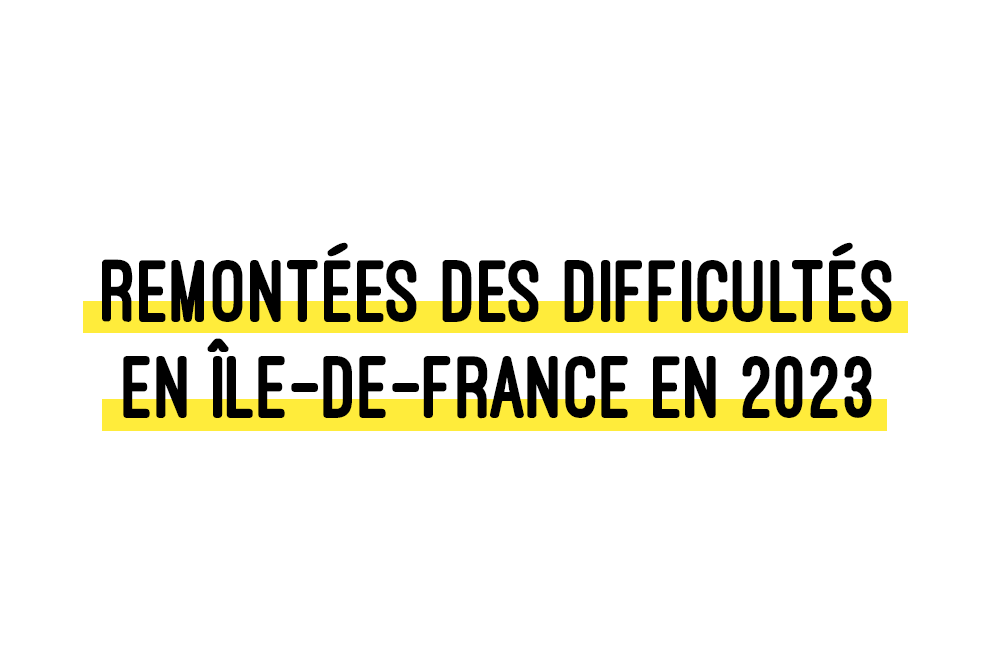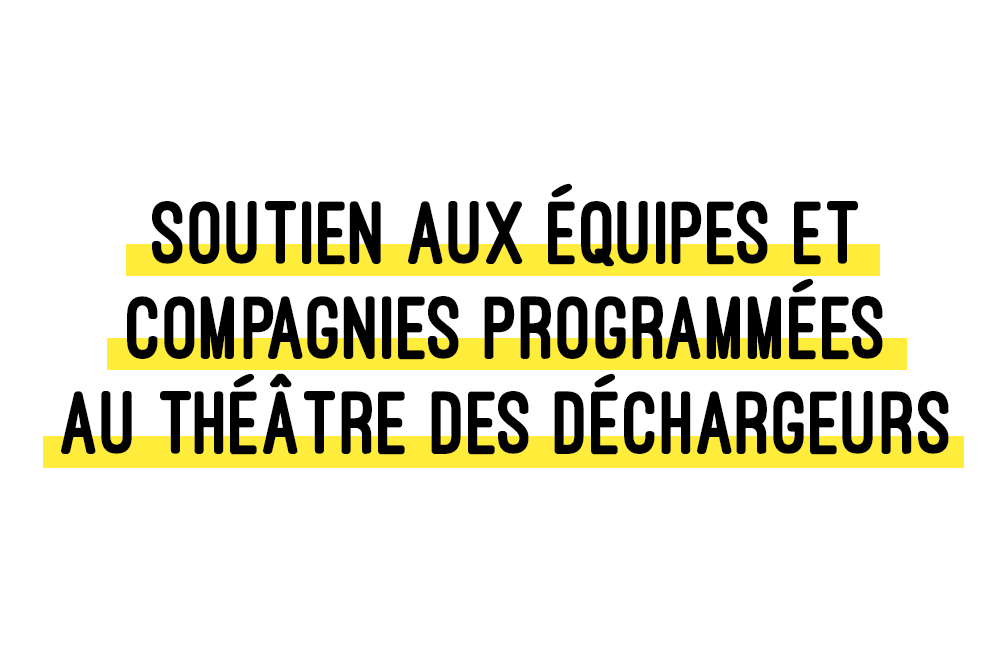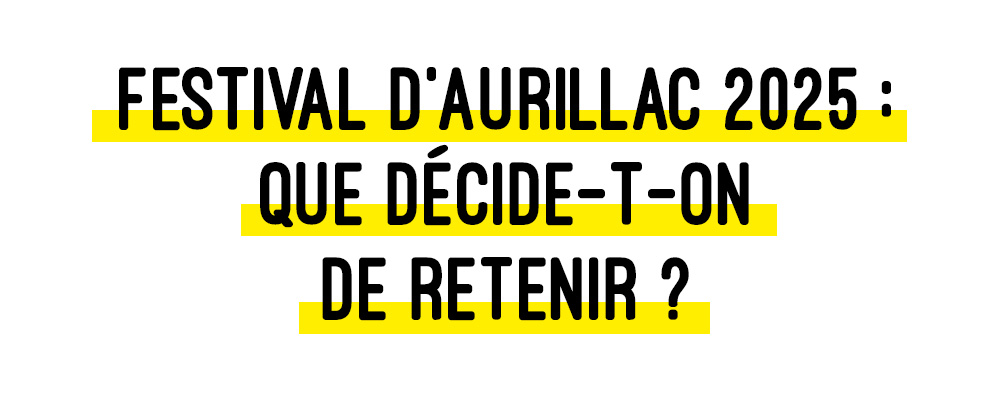
Communiqué
Cette année, pour sa 38ème édition, le festival d’Aurillac a accueilli près de 650 compagnies venues du monde entier. Elles ont proposé quelque 750 spectacles à plus de 180 000 spectateurs et spectatrices.
À Aurillac on ose, on essaye, on prend des risques, on cherche. On discute, on échange, on expérimente. Ce festival est un des rares moments où tout cela est possible, un des rares espaces à être réellement rendu public pour l’occasion, où la rue est réinvestie par les citoyen·nes, artistes, spectateurs et spectatrices. Les artistes, collectifs et compagnies sont de plus en plus nombreux·ses à s’inscrire pour participer au festival. C’est un événement nécessaire, tant pour les publics que pour les professionnel·les. Un rendez-vous qui nous tient à cœur, que nous défendons et continuerons de défendre.
Cette édition s’est ouverte jeudi par une mobilisation des travailleur·euses de l’art et de la culture, mobilisation nécessaire dans le contexte de restrictions budgétaires et de tensions sociales et politiques que nous connaissons.
Cette année, la France entière a entendu parler du festival par la voix des médias nationaux. Ça pourrait être une bonne nouvelle, mais c’est le contraire. Les médias se sont emparés des violences qui ont eu lieu le premier soir, et en ont fait leurs choux gras. Nous trouvons cela inacceptable. À l’exception de la presse locale, les médias, notamment culturels, mettent rarement un pied dans ce festival, ou dans les événements que nous construisons, qui existent pour certains depuis plusieurs décennies et connaissent un succès toujours confirmé. Comment ne pas ressentir cette absence comme du mépris, malgré l’histoire des arts de la rue et de l’espace public en France, les temps forts à résonances internationales, malgré l’histoire même du spectacle vivant ? Comme si nos spectacles, nos politiques de gratuité, la diversité de nos propositions et de nos publics, qui illustrent et portent une véritable ambition de démocratisation culturelle, n’avaient pas d’intérêt. Pourtant, nos festivals, outre leur valeur artistique, génèrent également beaucoup de profits financiers. On s’en fiche un peu, c’est pas pour ça qu’on le fait. Nous ne voulons pas être assimilé·es à la bourgeoisie culturelle, mais le dédain affiché pour nos pratiques nous heurte, et blesse par la même les publics qui se déplacent en masse pour assister à nos spectacles.
On ne sait pas précisément ce qui s’est passé dans la soirée du mercredi 20 août lors des affrontements entre les personnes et les forces dites de l’ordre. Et nous déplorons, bien évidemment, la violence et les dégâts causés par ces altercations. Mais elles nous semblent aussi être le symptôme d’un malaise socio-politique profond qui aurait mérité un traitement médiatique et une analyse un peu plus poussés.
Comme le souligne le sociologue Michel Kokoreff : “Depuis 2002, nous assistons à un durcissement de la situation sociale et des rapports entre les populations et les institutions. Les ingrédients sociologiques sont réunis pour que des explosions se produisent” (dans son article Sociologie de l’émeute. Les dimensions de l’action en question).
Depuis l’instauration du plan vigipirate, le dispositif policier est de plus en plus important dans le festival. En parallèle, et de manière nous semble-t-il beaucoup plus efficace, des équipes nombreuses et motivées de bénévoles travaillent activement pendant tout le festival d’Aurillac (et les autres festivals et événements) à faire de la médiation, gérer les conflits, avoir une vigilance accrue sur les questions de violences, notamment sexistes et sexuelles. Le traitement médiatique des affrontements du mercredi soir a malheureusement invisibilisé le travail des équipes salariées et bénévoles du festival. Ce qui devrait être mis en lumière, ce qui devrait être raconté au grand public, c’est que depuis des années ce festival rassemble plus de 150 000 spectateurs et spectatrices par édition, près de 2 000 artistes, pendant 4 jours, dans une ville de moins de 30 000 habitants, et que les événements qui mettent en péril la sécurité des biens ou des personnes sont extrêmement rares. Combien de rassemblements de cette envergure, qu’ils soient culturels ou sportifs, peuvent se targuer de rassembler autant de gens dans l’espace public, avec autant de libertés de circulation, et si peu de mises en danger ?
Bien entendu, nous réclamons qu’il n’y ait aucune violence, aucun dégât, aucune personne blessée. Toutefois, un événement qui réunit autant de personnes est forcément révélateur de notre société, et cette société est violente. Nous pensons qu’une présence toujours plus accrue de bénévoles, de personnes formées à la médiation et à la désescalade serait une réponse plus adaptée aux rares situations de conflits. Rappelons-nous toujours que nous faisons société tous et toutes ensemble, et interrogeons-nous sur les moyens de guérir plutôt que de faire clivage. Nous sommes aussi faits de ce qu’on nous fait. Les Arts de la rue et de l’espace public, à travers notamment le Festival d’Aurillac, ont à cœur de réunir, questionner, partager, émouvoir, fêter, avec un public le plus large et divers possible, dans le respect et la joie. Un projet de vivre ensemble en quelque sorte. L’ambition, justement, de faire société.
« En ces jours,
où l’espace marchand prend toute la place,
où la peur est brandie pour nous faire penser bas et dresser nos œillères,
où les bornes, les panneaux, les barrières se multiplient,
où l’on est prié·e de circuler,
Nous revendiquons haut et fort qu’il y a quelque chose à voir,
à partager,
à rencontrer,
des centaines de fêtes et de rendez-vous, des milliers d’artistes,
des millions de spectateur·ices, ce quelque chose que nous,
Artistes citoyen·nes inscrit·es dans la cité nous nous employons à construire
jour après jour !
Nous revendiquons le droit à vivre de nos métiers
Nous croyons que l’art peut sauver le monde,
mais de préférence tout de suite…
Et qu’il doit s’épanouir…
En rue libre… ».
Manifeste pour les arts de la rue
La FéRue – Fédération des arts de la rue en Île-de-France